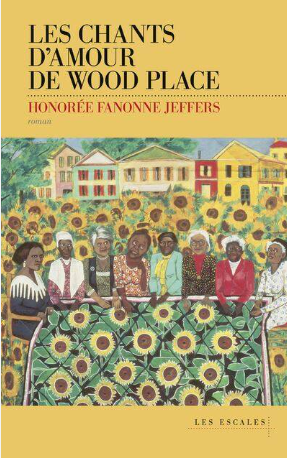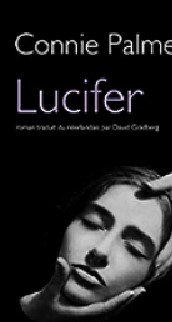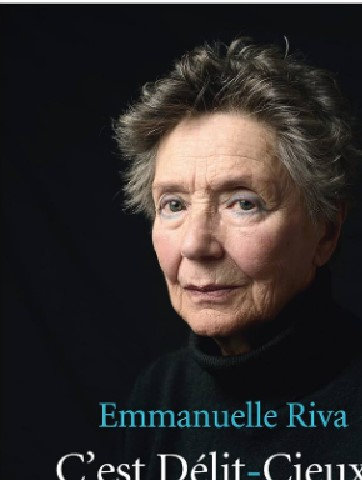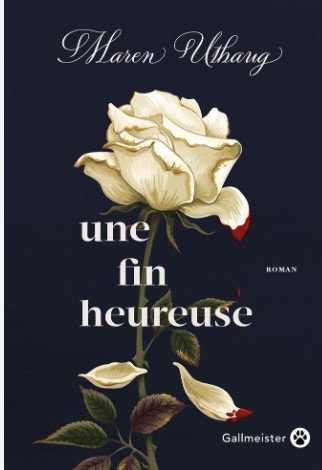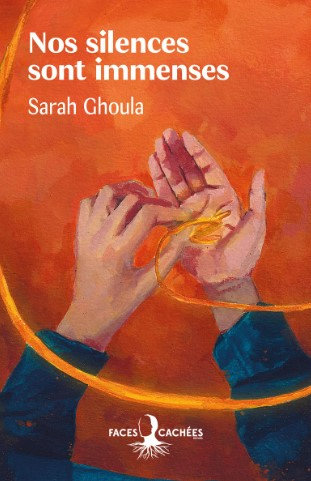La demeure du vent
La demeure du vent
de Samar Yazbek
Ali est un jeune homme qui vit dans un village pauvre en Syrie, c’est un sauvageon dans le sens où il respire avec la nature, les arbres, le ciel, l’herbe, les fleurs, les animaux… Après 3 ans de guerre, il est enrôlé de force dans l’armée.
Dès la première page de ce fabuleux roman (oui oui fabuleux), Ali gît non loin d’un grand chêne, comme celui de son village, blessé parmi les feuilles. Tous les autres membres de son groupe paraissent morts. Son but alors, est d’arriver à rejoindre l’arbre, de se mettre sous sa protection. Entre ses moments de lucidité et ses délires, il remonte sa vie. Du jour de sa naissance où pendant quelques heures aucun son n’est sorti de sa bouche, à ce jour allongé dans les feuilles au milieu des trous d’obus.
Ali est le fils de Nahla, le second de 5 enfants. Sa naissance « particulière » lui vaut d’être « adopté » par la Rouquine, la vieille gardienne du sanctuaire qui le prend sous sa protection. Page 55. Personne ne connaissait le vrai nom de la Rouquine, et elle-même disait qu’elle l’avait oublié. Il se racontait qu’elle s’appelait en vérité Yamama, « La Colombe ». Cependant, un jour qu’Ali était lové dans ses bras, elle s’était levée brusquement pour cracher au visage d’un des hommes qui l’avait appelée ainsi : « Yamama est morte, avait-elle protesté. – Mais alors comme tu t’appelles ? » s’était enquis l’homme, interloqué. Ce à quoi elle avait répliqué : « Je suis la sœur de l’arbre, imbécile, et Ali, que tu vois là, est son fils ! » Elle l’initiera à leur fois ancestrale, son école de vie est la nature, la respiration des arbres, le lever du soleil et son coucher… tout sauf l’homme qui détruit. Sa vie en plus de la Rouquine, c’est sa mère qu’il adore, son respect pour la vie difficile qu’elle subit, la baguette de grenadier que son père n’hésite pas à se servir contre lui, c’est son refus de rentrer dans le rang comme d’aller à l’école. Pages 176 et 177. Ali avait toujours su estimer l’âge des arbres, reconstituer leur histoire et distinguer leurs différentes espèces. D’où lui venait cette connaissance, mystère ! Aux dires des villageois, c’était la Rouquine qui lui avait transmis ses secrets, mais la vérité, c’est qu’il avait découvert par lui-même tout ce que recelaient les bois environnants, un monde qu’il avait touché du doigt et au milieu duquel il avait grandi, accumulant des connaissances en biologie des plantes et des arbres et glanant un savoir auquel n’accèdent en principe que les animaux sauvages.
Il essaie de ramper par à-coups, en s’aidant de ses coudes, et examine le terrain accidenté, rêvant de retrouver sa cabane. Il se rappelle comment il s’était posté au pied du tronc pour monter la garde quand Nahla était venue s’y réfugier, la nuit où ils avaient enterré son frère aîné. Il la surveillait, assise près de la paroi sans s’y adosser, les genoux rassemblés sur la poitrine, roulée en boule comme un hérisson. De temps à autre, il piquait du nez quelques instants, mais dès qu’il reprenait ses esprits, il se remettait à observer le dos bombé de sa mère. Il s’était tenu coi au pied de l’arbre, n’osant faire le moindre mouvement, et l’avait surveillée jusqu’à ce que le sommeil finisse par l’emporter.
À travers l’histoire d’Ali, on découvre la vie des petits villages syriens avant et pendant la guerre, le durcissement politique, religieux, les pertes de libertés, la pauvreté de plus en plus étendue, les disparitions des gens qui en se plient pas aux nouvelles règles ou qui tout simplement restent eux-mêmes…
Ce texte n’est que poésie, d’une écriture incroyable, Samar Yazbek manie les mots avec une habilité qui est telle que la guerre reste en second plan, alors qu’elle est le destin d’Ali. Elle nous fait monter dans les arbres, courir avec le vent, teindre les cheveux de la Rouquine, découvrir les rites hommes-femmes avec grâce. Elle fait ressortir toute la beauté de ce peuple massacré.
Je recopie ici, un passage de la quatrième de couverture, car je pense qu’il n’y pas de meilleurs mots pour le faire : « Samar Yazbek questionne avec force et poésie le lien entre l’homme et la nature dans une société rongée par la violence, qui détruit ce qu’elle a de plus sacré. Un grand texte sur la beauté et l’âpreté de l’existence ».
Ce livre m’a enchanté, transporté, malgré la rudesse de l’histoire. C’est magnifique !! Et toute mes félicitations aux traducteurs Ola Mehanna et khaled Osman.
Claude
Première page
Une toute petite feuille, si petite que ses cils visqueux l’empêchent de la voir dans l’éclat du soleil de midi.
Une petite feuille d’arbre, rien de plus. Une feuille d’arbre verte, nervurée, qui lui voile les yeux comme de la gaze lorsque lentement, péniblement, il remue les paupières. Une feuille d’arbre qui adhère à ses longs cils collés par la boue. Une feuille d’arbre qui l’empêche de voir distinctement, surtout avec ces grains de poussière qui nagent dans le liquide de ses yeux, lui causant irritation et douleur. S’il parvenait à reprendre le contrôle de ses paupières pour ouvrir les yeux, la feuille tomberait à l’intérieur de l’œil gauche.
Le monde entier se ramène à cette feuille. Il n’y a pas un bruit, pas une odeur. Quant à son autre œil, il ne le sent pas. Est-il seulement capable de voir ? Peut-être. Mais a-t-il même un corps ?
La demeure du vent, de Samar Yazbek, traduit du syrien par Ola Mehanna et Khaled Osman. Éditions Stock – la cosmopolite.
/image%2F1238501%2F20240301%2Fob_6eabcf_capture-d-ecran-2024-03-01-172919.png)